Parlez-vous "globish" ?
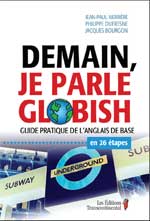 Xavier Darcos affirme vouloir
« une France bilingue ». Où en est-on en
réalité ? La plupart du temps, pas
vraiment au top !
Xavier Darcos affirme vouloir
« une France bilingue ». Où en est-on en
réalité ? La plupart du temps, pas
vraiment au top !
Interrogé par un journaliste anglais à Marcoussis le mois dernier, le rugbyman Sébastien Chabal avait sèchement renvoyé l’importun dans ses « 22 » : « On est en France, monsieur. On parle français. » Bravo ! Belle répartie, qui rappelle l’agacement de Jacques Chirac face à Ernest-Antoine Seillière s’exprimant en anglais dans une enceinte européenne, en mars 2006. Oui, mais voilà, tout le monde ne peut pas se le permettre. Il suffit de lire les petites annonces : mieux vaut s’afficher anglophone quand on cherche un emploi.
Du “top manager” à l’assistante, de l’hôtesse d’accueil à l’ingénieur, il faut être fluent, sinon rien. Les recruteurs n’hésitent d’ailleurs pas à vérifier que le CV colle bien à la réalité. Quelques questions bien senties en anglais au cours de l’entretien d’embauche, et malheur aux truqueurs !
La standardiste doit savoir accueillir en anglais ses interlocuteurs étrangers, le directeur d’usine convaincre ses clients, le juriste rédiger ses contrats, l’informaticien traiter avec ses sous-traitants indiens, espagnols, japonais, chinois… Certains groupes en ont même fait un principe de base : chez Renault, tous les salariés doivent atteindre un niveau minimal d’anglais, qui est régulièrement contrôlé.
D’autres, pour économiser la traduction, imposent la langue de la City dans les réunions regroupant des cadres de toutes nationalités. Lors des colloques internationaux, en dehors des enceintes officielles où le français garde sa place, nul ne traduit plus les orateurs s’exprimant en anglais. Et tant pis s’ils ont parfois un accent à couper au couteau : le monde entier n’a qu’à comprendre ! La lame de fond anglophone a balayé les autres langues. Non pas qu’elles ne soient pas appréciées des entreprises. L’espagnol, l’italien ou même l’allemand – langue de notre premier partenaire commercial – restent souhaitables, mais pas indispensables. Guère plus qu’une cerise sur le pudding…
Les PME ne sont pas épargnées. Alban Muller est une entreprise moyenne de Fontenay-sur-Eure, qui réalise 66 % de son chiffre d’affaires à l’export.
« L’anglais est indispensable pour les commerciaux en relation avec les distributeurs du monde entier, pour les dirigeants des laboratoires ou pour les responsables environnement et qualité qui font très souvent visiter nos sites », souligne Béatrice Pineau, responsable des ressources humaines. Ici, peu importe l’accent et la précision grammaticale : il faut pouvoir communiquer avec un Texan comme avec un Coréen, comprendre une réclamation au téléphone, présenter un mémo rapide en anglais, conduire une négociation commerciale avec un partenaire…
Encore faut-il trouver les candidats ad hoc. Pas si simple ! Au plus haut niveau, pas de problème : sur les campus des écoles de commerce, l’international est au menu tous les jours. Les élèves de Sciences-Po Paris passent deux années à l’étranger durant leurs études. La plupart des grandes écoles rivalisent d’ouverture, organisant à qui mieux mieux échanges de professeurs et d’étudiants, années ou semestres d’études à l’étranger et même diplômes communs à plusieurs établissements de par le monde. À ce niveau-là – et en payant le prix fort, bien sûr –, on parle anglais autant que français et l’on s’initie même aux langues des désormais fameux Bric : Brésil, Russie, Inde et Chine. L’université, plus modestement, favorise de plus en plus les échanges, surtout après la licence. Chacun connaît le programme Erasmus. Mais les autres ? Les techniciens, les artisans, les employés ? Pour ceux-là, l’anglais des entreprises, ce “globish” (global English) pourtant souvent basique, est le plus souvent hors de portée.
Conscients de ne pas être à la hauteur des exigences des recruteurs, les plus jeunes et les plus volontaires prennent… l’Eurostar. Pour s’améliorer en anglais “à la source” bien plus que pour goûter aux joies du libéralisme anglo-saxon, ils acceptent temporairement des jobs parfois très modestes et se logent, à prix d’or et à plusieurs, au fin fond des banlieues londoniennes. Certains vont garder des enfants aux États-Unis, hisser les parasols des plages maltaises ou même faire les vendanges en Australie. C’est ce que les responsables des ressources humaines appellent l’année de césure, entre études et entrée dans le monde du travail.
Non pas que l’Éducation nationale n’ait rien fait pour eux. Le ministre, Xavier Darcos, a répété vouloir « une France bilingue ». Il n’est pas le premier : depuis une vingtaine d’années, les plans en faveur des langues étrangères se succèdent, avec des résultats… inégaux. Théoriquement, on peut présenter 64 langues au bac. Parfait, mais les élèves français sont loin de maîtriser celle de Shakespeare, à la fin de leur scolarité.
Une étude comparative a été faite en 2002 dans sept pays européens : Suède, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Norvège, Espagne et France. Les compétences en anglais des jeunes Français sont « nettement inférieures à celles des élèves des six autres pays participants, et cela dans tous les domaines évalués » : compréhension de l’oral, de l’écrit et compétences linguistiques. Pis, leurs performances ont « fortement baissé » par rapport à la même enquête menée six ans auparavant, en 1996. Un quart seulement des élèves ayant choisi l’anglais en première langue le parlent et le comprennent « bien ou très bien » à la fin du collège, précise une autre note d’évaluation du ministère. Et « s’agissant de l’expression écrite, ils sont bien moins nombreux à atteindre cette maîtrise ».
Il y a urgence. Aujourd’hui, 98 % des enfants étudient une langue dès le cours élémentaire, vers 8 ans. Au collège et au lycée, tous étudient deux langues (en général le duo anglais-espagnol), voire trois. Sections européennes et internationales, présence d’assistants étrangers au lycée, classes bilangues – anglais et allemand – dès la sixième : l’Éducation nationale redouble d’efforts, notamment depuis la loi Fillon de 2005. La volonté est là, surtout, d’utiliser toutes les ressources, des jumelages locaux aux partenariats, de désenclaver les langues en les combinant à d’autres disciplines, d’associer les filières professionnelles à cet effort. Selon les recommandations d’un rapport sénatorial passionné remis en 2003, on pourrait même aller jusqu’à « casser » les classes traditionnelles pour créer des groupes de niveaux mieux adaptés aux performances des élèves.
« L’amélioration est désormais qualitative », assure Jean-Daniel Roque, chargé au ministère de la sous-direction des écoles, collèges et lycées. « Les programmes, fondés sur un cadre européen commun, mettent l’accent sur l’oral et la communication, sur la pratique quotidienne plus que sur les textes littéraires. La connaissance des langues est prise en compte dès le concours d’entrée des IUFM, leur formation progresse. Dans dix ans, on verra la différence… »
Bonne nouvelle : les générations futures
seront mieux loties que les précédentes.
Mais en attendant ? En attendant, les
professeurs des écoles, héritiers du
système scolaire d’il y a quelques
décennies, ne peuvent guère enseigner
une langue étrangère qu’ils n’ont jamais
maîtrisée. Et les intervenants
extérieurs aux compétences inégales ne
sont pas faciles à trouver.
L’enseignement au primaire reste donc
chaotique, et souvent à reprendre
quasiment à zéro au collège. Les 6 000
postes offerts en lycées et collèges
chaque année à des assistants étrangers
ne sont jamais complètement pourvus : ne
pouvant pas valider dans leurs cursus
l’année accomplie en France, les
étudiants qui devraient occuper ces
postes ne se bousculent pas au
portillon. Les sections européennes,
bien loin de répondre à la demande des
familles qui les considèrent comme des
classes d’élite, n’accueillent que 7,4 %
des élèves de première et de terminale.
Au fil des années, l’angoisse des parents et des élèves gagne du terrain : l’anglais, incontestablement nécessaire, sera-t-il toujours suffisant ? D’où l’engouement actuel des jeunes pour le chinois ! Plus de 10 000 collégiens et lycéens s’acharnent aujourd’hui à percer les mystères des idéogrammes. À Issy-les-Moulineaux, ville exemplaire en la matière, les quatre collèges et le lycée s’y sont mis : « Il est vrai que la commune, dirigée par un André Santini passionné par les langues orientales, nous a aidés, notamment grâce aux jumelages », précise Ronan Durand, proviseur du lycée Eugène-Ionesco. Au niveau national, le chinois n’est pas loin de détrôner l’italien pour devenir la quatrième langue des Français ! Il y a quelques années, c’est le japonais qui semblait émerger, mais il est passé de mode. L’espagnol seul se maintient tandis que l’allemand est délaissé, le russe ne décolle pas, l’italien vivote, l’arabe reste marginal. Le chinois sera-t-il un feu de paille ?
Bon gré mal gré, les Français consacrent
donc bien l’essentiel de leur effort à
ce “globish” que le monde leur impose.
Tout en sachant qu’ils auraient tort de
négliger un atout qui leur est propre,
une langue que près de soixante pays ont
en commun dans le monde : le français !
Comme disait M. Chabal…
La formation continue ramasse la mise
Danielle ne cache pas sa fatigue, en fin de journée, en quittant les locaux de Formalangues, au cœur de Paris. Quand on a terminé ses études trente-cinq ans plus tôt, pas facile de retrouver la concentration qu’exigent casques et écrans… Cette étudiante de 54 ans a pourtant de la chance : demandeur d’emploi, elle a obtenu 180 heures de formation en anglais pour se remettre à niveau. Une dose qu’il faudra sans doute doubler pour obtenir le niveau nécessaire à la reconversion envisagée. Danielle est loin d’être seule dans son cas. S’il est un secteur qui ne se plaint pas des tâtonnements linguistiques des Français, c’est bien la formation continue. On y connaît une croissance constante, malgré la concurrence impitoyable que se livrent organismes privés et publics : ils sont un millier environ sur ce marché. « On nous demande surtout de l’anglais de la banque, de l’assurance, du marketing, précise Michaela Karp, responsable de Demos Langues. Un enseignement souvent très technique et, plus que des cours, des opérations de training ciblées… » Tel manager a une présentation à faire devant un client japonais la semaine prochaine ? Son entreprise lui offre aussitôt une préparation axée sur ce moment crucial : il s’agit de maîtriser le sujet et d’envisager toutes les questions qui pourront être posées tout en soignant le naturel. Même chose pour un entretien d’embauche qu’un responsable des ressources humaines doit mener à New York ou à Sydney. Le filon est presque inépuisable. « Non pratiquée, une langue s’étiole. Il faut remettre l’ouvrage sur le métier pour retrouver ses bases ou les approfondir », remarque Philippe Marec, président de la commission langues de la Fédération de la formation professionnelle. Problème : dans ces formations où les heures s’accumulent vite, la clientèle trouve vite qu’être condamné à l’anglais à vie coûte cher… D’où le succès, en appoint, des méthodes proposées sur Internet. L’une d’entre elles, Gymglish, donne sans fard cet apprentissage pour ce qu’il est : une gymnastique sans prétention, mais à renouveler quotidiennement, sous peine de voir ses articulations rouiller !
Christine Murris
************************************