Le « Tout va très bien, Madame la Marquise » des linguistes atterré(e)s !
Linguistique et idéologie...
Voici quelques commentaires à bâtons rompus sur le manifeste des « Linguistes atterré(e)s » qui ont publié « Le français va très bien, merci, » aux éditions Gallimard, tracts.
par Maurice Pergnier, linguiste
Cet opuscule, dont la tonalité très polémique est affirmée dès le titre et la couverture, se présente – en résumant à grands traits, mais sans en trahir l’esprit général – comme une virulente diatribe contre « ceux » qui opposent une résistance à certaines évolutions introduites récemment dans l’usage de la langue française.
En contrepoint, cette diatribe est, bien sûr, mise au service de la défense et de la promotion desdites innovations. On aura compris qu’il s’agit de sujets comme la féminisation des appellations, l’écriture inclusive, la « genrisation » de la grammaire, mais cela concerne aussi l’anglicisation à outrance, l’accord du participe avec avoir, etc. Note de l'Afrav : l'attitude des linguistes atterré(e)s n'est pas sans nous rappeler la chanson « Tout va très bien, Madame la Marquise » de Paul Misraki : Les offensives dans le même sens sont actuellement monnaie courante, notamment dans les cercles universitaires et dans les milieux de la communication. L’auteur de ces lignes ne se serait pas donné le mal d’intervenir dans ce débat (qui concerne l’ensemble des Français et des francophones) si les signataires de ce pamphlet ne prétendaient fonder leur position militante sur l’autorité scientifique d’une discipline qui est la sienne, et dont les principes et méthodes sont présentés, non seulement comme cautionnant, mais comme préconisant, sans contestation possible, le bien-fondé de ces nouvelles pratiques langagières. Il a, en conséquence, le devoir d’attirer l’attention sur le fait que cette prétention relève, soit d’une candeur déconcertante, soit d’une intention mystificatrice. On voudra bien excuser le caractère quelque peu « au débotté » et peu construit avec lequel ce commentaire s’emploie à tenter de le montrer.
Les auteurs
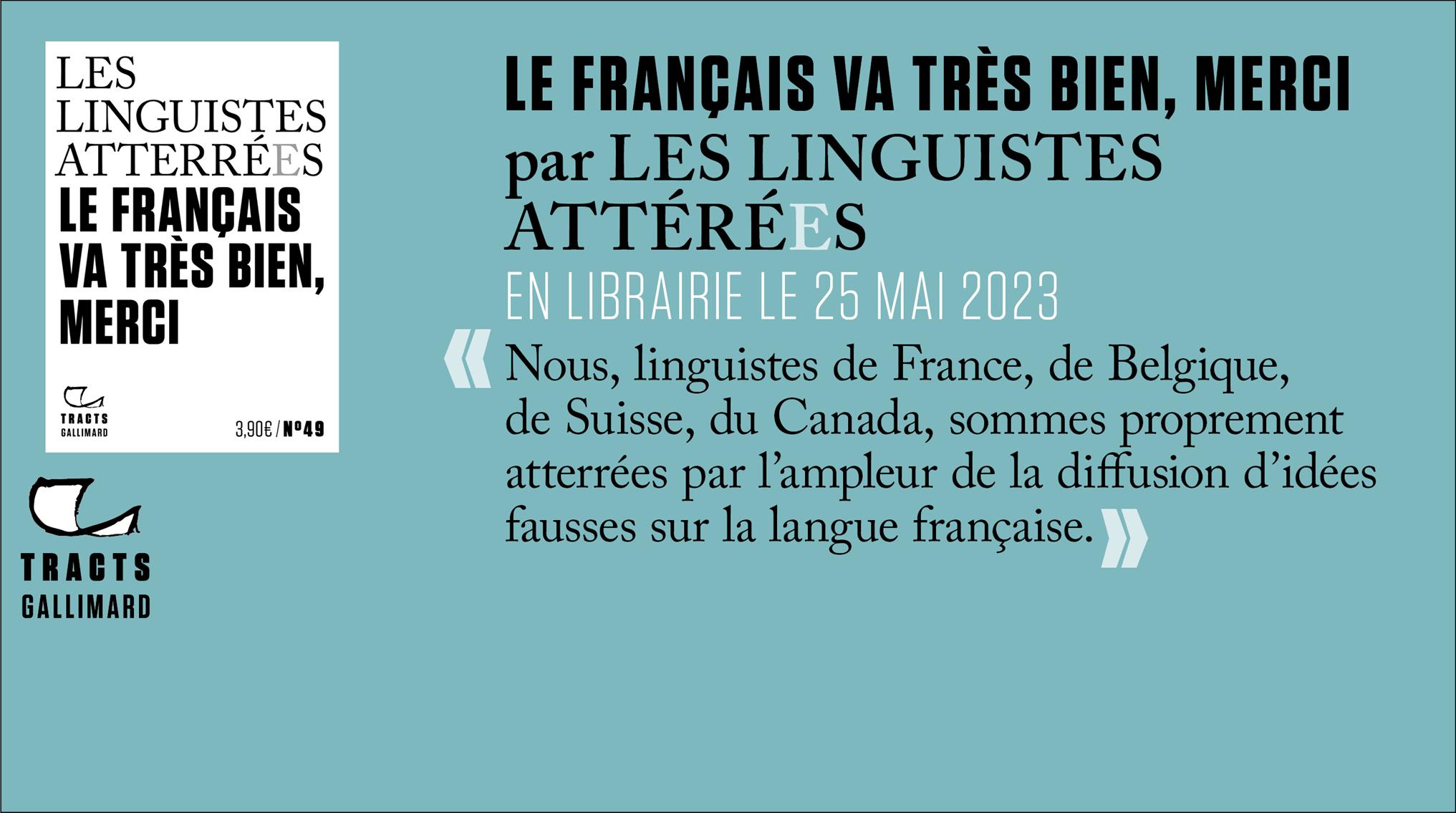
Ce pamphlet émane d’un collectif de linguistes s'exprimant, si l’on ose dire, ex cathedra, au nom de « la linguistique ». L'ouvrage commence d’ailleurs ainsi : « Nous, linguistes, ... ». Certes mes collègues n'écrivent pas « Nous, les linguistes... » ; mais cet incipit – qui sonne en écho du célèbre « We, the people... » – peut-il être interprété par le lecteur non prévenu autrement que comme signifiant : nous, qui sommes la voix (unanime) de la linguistique ?[1]Ayant, pour ma part, voué ma vie professionnelle à la défense et illustration de cette discipline (et, accessoirement, consacré quelques réflexions au destin de la langue française), je ne pouvais rester indifférent à un écrit se présentant ainsi. On se souciera sans doute bien peu de mon opinion ; il ne m’a néanmoins pas paru totalement incongru de la donner, en toute confraternité avec mes collègues de la nouvelle génération, qui s’expriment dans ce texte au nom de principes qui guidèrent les recherches et positionnements de plusieurs générations précédentes.
Or, je dois confesser d’emblée que, plus je progressais dans la lecture, moins je trouvais de raisons de me trouver enrôlé dans ce prétendu unanimisme. Bien au contraire.
Certes, nombre de considérations concrètes développées au fil du texte font partie du fond commun partagé par la plupart de ceux qui se disent linguistes ; mais il n'en va pas de même des conclusions qui en sont tirées, ni de l'objectif qu'on veut leur faire servir. Concernant ce dernier, il est affiché très clairement dès la page de couverture : il s’agit de promouvoir avec bienveillance, voire d’imposer, un certain nombre de pratiques langagières que nombre de francophones sont réticents à adopter. Pour abattre les résistances de ces derniers, on convoque les « acquis de la linguistique » au service de l’idée qu’il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'état présent de la langue française et son devenir. Baisse des compétences en orthographe et en grammaire, écriture inclusive et « genrisme », avancée du « franglais », etc. ? Rien de tout cela ne mérite qu’on s’y arrête et qu’on s’interroge. Tout témoigne, au contraire, d'un progrès constant et d'un enrichissement sans précédent. Comme dans le cochon, tout est bon ! C'est le tableau qui sera déroulé au long des pages.
[1] Rien, dans les pages qui suivent, ne vient démentir cette impression première. Ils écrivent d’ailleurs, quelques pages plus loin, que « ce manifeste entend rassembler ce qui fait consensus dans la communauté scientifique ».
La cible
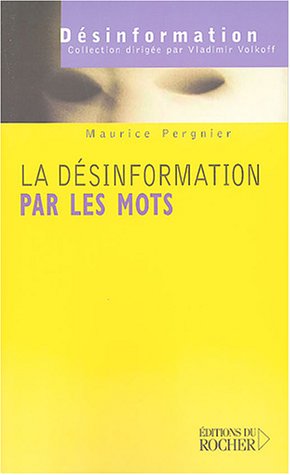
Mais, si tout va si bien, pourquoi mes chèr.e.s (ou cher.e.s ?) collègues sont-iels atterré.e.s[2] ? Leur atterrement est dû à « l'ampleur de la diffusion d'idées fausses sur la langue française », idées fausses qui font un barrage à la réception triomphale du progrès de la langue énoncé ci-dessus et – secondairement, mais non moins abusivement – à la réception heureuse des principes énoncés par nos « linguistes atterré(e)s » et qui sont censés résulter directement du savoir scientifique de « la linguistique ».
Les considérations ci-dessus renvoient toutes aux pages introductives. En avançant dans la lecture, les choses se précisent dans un sens qui laisse le linguiste candide (non atterré) que je suis, de plus en plus perplexe. Ce n'est pas caricaturer, mais simplement forcer un peu le trait, que de résumer cette vision de la façon suivante : le monde (enfin, le petit monde qui se mêle d'avoir une opinion sur la langue) se divise en deux groupes : d'un côté, un immense troupeau ignorant, marchant dans la pénombre sous la houlette de guides œuvrant à le maintenir dans l'obscurantisme (on découvrira au fil des pages que l'une des institutions les plus maléfiques en la matière est l'Académie française), et qui vit dans une inquiétude résultant seulement de son ignorance ; de l'autre côté, les linguistes, portant le flambeau lumineux du savoir et ne demandant qu'à en faire bénéficier les foules et leurs guides ignares.
Si, dans ces paragraphes de présentation du manifeste, on se permet d'user quelque peu du persiflage pour en présenter la thèse générale, c'est que – comme quiconque prendra la peine de le lire pourra le constater – ses rédacteurs ne sont, pour leur part, pas en reste dans le maniement de la caricature simplificatrice. Selon eux, les Béotiens du troupeau qui n'a pas eu la chance d'être initié à leur linguistique partagent un ensemble de croyances archaïques : Ils ignorent que les langues évoluent dans le temps ; il prennent au pied de la lettre l'expression « la langue de Molière », et s'imaginent que Sganarelle ou Harpagon s'expriment comme les personnages de nos feuilletons télévisés ; ils ne se sont pas aperçu(s ?) que l'orthographe ne reflète pas exactement la réalité du français oral (d’où vient, alors, demandons-nous en passant, qu’ils la trouvent difficile ?) ; ils ont une « lecture nationaliste » des mots (p. 18) ; ils pensent que le summum de la philosophie du langage et de l'attachement à la langue française réside dans la dictée de Bernard Pivot. Et leur existence est régie par la hantise de la faute d'orthographe. Ah ! la peur de la faute ! Quelle inhibition pour jouir de la créativité extraordinaire de notre français contemporain !
Notre collectif de rédacteurs se réclame fortement de sa position d'observateur (et non de prescripteur). On est donc en droit de se demander où ils ont observé ce ramassis d’imbéciles. Certes, dira-t-on, il ne s'agit pas ici d'un traité, mais d'un pamphlet, revendiqué tel. Il est donc d'usage, dans ce genre littéraire, pour atteindre son but, de créer de toute pièce une baudruche représentant l'antinomie de ce qu'on veut prouver. Mais si la baudruche n'est pas vraisemblable, n'est-ce pas la pertinence des flèches qui va en souffrir ?
Ce n'est pas l'auteur de ces lignes qui va nier que nombre d'idées préconçues – sur la langue française mais, encore plus, sur le langage en général ! – imprègnent la pensée commune, et que la linguistique a dû en faire litière pour progresser dans la connaissance de cet objet infiniment complexe qu’est le langage humain ; mais il doit avouer ingénument qu'il n'a jamais rencontré – ni dans le public en général, ni chez ses étudiants, ni même … chez les académiciens – de sujet parlant français qui adhère, comme à un credo, à l'ensemble des âneries qui lui sont prêtées dans ce livre.
Mais passons sur ces artifices oratoires – arsenal traditionnel du discours polémique – pour en venir au fond. Disons d'emblée que le problème soulevé à la lecture de ce livre ne réside pas dans l'appréciation de la justesse ou de la fausseté des quelques principes linguistiques qui y sont exposés, mais dans le détournement qui en est fait à longueur de pages pour bétonner un discours engagé. On a compris que, dès son titre et sa page introductive, ce livre se pose comme un vibrant plaidoyer en faveur du laisser-faire intégral vis-à-vis de toutes les « évolutions » (langue genrée, orthographe des participes, anglicisation du lexique, etc.) qui travaillent présentement la langue française et que certains (et peut-être une majorité, mais les sondages font défaut…) ont l'impudence de trouver préoccupantes. C'est parfaitement le droit de ce collectif d'auteurs de défendre cette position ; le problème réside dans la façon dont la linguistique est mise au service de ce plaidoyer.
[2]Qu’on ne voie dans le choix de cette graphie que le souci de ne pas paraître fuir d’emblée le terrain sur lequel les auteur.e.s de ce pamphlet ont placé le débat – dès la couverture – dans la formulation de leur raison sociale (linguistes atterré.e.s). Mais, qu’on se rassure (ou, au contraire – selon les goûts – qu’on veuille bien me le pardonner !), je ne persévérerai pas dans cette bonne disposition (les… auteurs du pamphlet, et je leur en rends grâce, nous ayant d’ailleurs, pour l’essentiel, épargné eux-mêmes cette gymnastique visuelle dans le cœur de leur texte, malgré leur évidente bienveillance à son égard.).
Note de l'Afrav : Ci-dessous une vidéo dans laquelle deux membres du collectif des « Linguistes atterré(e)s » défendent leur cause dans l'émission « Le Grand entretien » de France Inter. N'hésitez pas, en allant sur YouTube visionner cette vidéo, à mettre un commentaire dans l'espace « commentaires » de la vidéo, et cela d'autant plus que France Inter, radio publique, n'a pas donné la parole à ceux qui pensent autrement que ces linguistes atterrants et qui ne sont pas adeptes, ce faisant, du « Tout va très bien Madame la Marquise ».
La caution de la linguistique
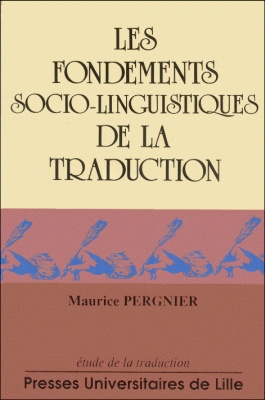
Les propos qui suivent ne seront compréhensibles par le non-spécialiste que si l'on balaie d'abord devant la porte d'entrée en posant la question : qu’est-ce qui est entendu ici précisément par « la linguistique » ? Au sens littéral, la linguistique désigne tout savoir, tout discours (à visée scientifique ou non) prenant pour objet le langage ou une langue en particulier (dans cette acception, M. Jourdain et son professeur faisaient, non seulement de la prose, mais de la linguistique sans le savoir !). Dans la pratique, depuis l'après première guerre mondiale, l'usage de ce mot s'est confondu avec les principes et méthodes d'une discipline à visée scientifique, dont les linéaments ont été introduits par le philologue suisse Ferdinand de Saussure. Le mode d'approche des faits de langage développé sous cette impulsion, et muri dans une semi-clandestinité pendant un demi-siècle, était proprement révolutionnaire, mais resta relativement confidentiel jusqu'aux années 70, où il connut une vogue sans précédent dans les universités, notamment du fait que les chercheurs d'autres sciences humaines s'en étaient saisis comme modèle, et que se créa alors le mouvement structuraliste. Ce succès devait immanquablement mener à un éparpillement (et même à un emballement) des recherches et de leur application pratique (dans le champ de la pédagogie, par exemple). D’autre part, comme on sait, la vague retomba, et la linguistique telle qu'elle était entendue jusque-là, fut concurrencée, dans l’engouement universitaire, par d'autres approches théoriques souvent fort éloignées qui bénéficièrent de la même appellation. « La linguistique » continua bien de creuser son sillon dans la sérénité, éloignée des effets de mode, qui sied à toute recherche fondamentale, mais en ayant perdu en route sa capacité d’attirer les jeunes chercheurs, captés par d’autres lumières plus en vogue (même si leur vogue fut souvent éphémère), pour diverses raisons qui n’ont pas à être évoquées ici. Cela ne se fit cependant pas sans que « la linguistique » laissât derrière elle un certain héritage souvent désigné comme des « acquis ». C’est à cette définition de la linguistique que nos auteurs font référence, et c’est donc sur ce seul terrain qu’on se permettra de questionner la pertinence de leur démarche, en tant que « survivant » de la période où ladite linguistique a suscité la plus grande effervescence dans les milieux universitaires.
C'est en effet sur certains desdits « acquis » que les auteurs du manifeste fondent leurs argumentations. On ne contestera pas à leur discours la qualité d’une judicieuse illustration de ce que doit être une initiation à la linguistique générale (ou plutôt, comme on le verra plus loin, à ses préalables). Arrêtons-nous aussi brièvement que possible aux principaux, qui structurent leur argumentation : d'abord, le fait que, si on veut mettre à jour les mécanismes linguistiques, on ne peut se fonder sur l'écriture, et on doit travailler sur la forme orale des mots (la place manque, ici, pour en donner les raisons). Ensuite, l'importance de distinguer radicalement entre la démarche prescriptive (celle des grammaires, dictionnaires, manuels de bon usage, etc.) – laquelle n’a pas pour vocation de faire apparaitre ce qui se joue derrière la production d'énoncés –, et la démarche descriptive qui, elle, vise à comprendre comment fonctionne le système d'horlogerie caché derrière cette production d'énoncés. Aussi les linguistes ont-ils, dès la naissance de la discipline, pris leurs distances avec les présentations normatives des faits de langue[3]. C'est d'ailleurs pourquoi la plupart d'entre eux refusent (à tort ou à raison) de prendre parti dans des débats ayant trait au « bon usage » ou à la planification linguistique.
Un troisième principe, acquis depuis Ferdinand de Saussure, est que le recours à l'histoire des mots et structures grammaticales de la langue ne rend en aucune façon compte de leur statut dans le système linguistique tel qu'il se présente à nous à un moment donné de son évolution, et qu'il faut donc bien distinguer l'analyse synchronique de l'analyse diachronique (qui, de son côté, nourrit d'innombrables traités et ouvrages de vulgarisation). Cela n'empêche pas la diachronie, chassée par la porte, de rentrer subrepticement par la fenêtre, puisque, comme le soulignent à juste titre nos auteurs, des pans de la langue évoluent continuellement devant nos yeux et nos oreilles.
Ces préceptes ne constituent pas à proprement parler les « acquis » de la linguistique, ils n'en sont que l'antichambre (les véritables acquis de la linguistique seraient à rechercher, non dans ces préambules, mais, par exemple, dans la découverte et la démonstration rigoureuse que la langue est un système dont toutes les parties sont solidaires et se définissent les unes par les autres[4]). Il n'est pas rare que, dans le public, et même chez des apprentis linguistes, ces principes méthodologiques soient détournés de leur fonction pour en tirer des conclusions hâtives et abusives. On ne peut que regretter que, ingénument ou dans l’ardeur du polémiste qui veut convaincre à tout prix, nos linguistes atterré(e)s flattent parfois cette tentation.
[3]Notons cependant, pour éviter tout manichéisme, que la ligne de démarcation entre les deux approches n'est pas toujours aussi facile à tracer qu'il y paraît : ainsi, a-t-on le droit de dire qu'un tableau des temps et modes des verbes français dans une grammaire « traditionnelle » est dénué de tout aspect descriptif ? Si normativé et prescriptif soit-il, il est bien une « description » d’un ensemble limité et coordonné de formes, sous-jacent aux productions langagières ; seulement, la façon dont il en organise la présentation, et les valeurs sémantiques qu'il leur attribue, ne permettent pas de rendre compte de leur véritable structuration interne et de la répartition de leurs emplois dans la parole.
Certes, aussi, ce tableau ne rend pas compte des variantes dialectales, populaires, et autres, auxquelles le linguiste accorde son attention au même titre qu’à la norme censée régir les performances langagières des locuteurs.Mais il faut aussi souligner que la tradition française de cultiver une norme de référence (souvent puisée chez les grands écrivains) n’a jamais empêché la prolifération d’argots, sociolectes, parlers régionaux en tout genre, dont nombre d’écrivains se sont, d’ailleurs, emparés avec bonheur (sans être ,pour autant, lapidés en place publique).
[4] Un « acquis » dont les auteurs du pamphlet ne semblent guère se soucier.
Note de l'Afrav : Ci-dessous une vidéo dans laquelle la joyeuse Julie Neveux, membre du collectif des « Linguistes atterré(e)s » défend sa cause dans l'émission Quotidien de Yann Barthès sur TMC. N'hésitez pas, en allant sur YouTube visionner cette vidéo, à mettre un commentaire dans l'espace « commentaires » de la vidéo, et cela d'autant plus que Yann Barthès n'a pas donné la parole à ceux qui pensent autrement que ces linguistes atterants et qui ne sont adeptes, ce faisant, du « Tout va très bien Madame la Marquise ». Au passage, vous noterez la réflexion absurde d'Arthur qui a donné le nom anglais « The Wheel » à sa nouvelle émission sur TF1 parce que c'est le titre original et que, selon lui, il ne pouvait rien faire contre. Bon aurait été de lui demander alors pourquoi le titre original de la série française « Dix pour Cent » a été traduit en anglais chez les Anglophones par « Call My Agent » ? Lui demander pourquoi ce deux poids, deux mesures ? Pourquoi les Anglophones auraient le droit de traduire les titres originaux d'oeuvres non en anglais, alors que les Francophones seraient condamnés à l'obligation d'employer les titres originaux en anglais ?
L’orthographe

Ainsi, ce n'est pas parce que la linguistique récuse le témoignage de l'écriture comme reflet direct des structures de la langue, qu'elle établit une hiérarchie de valeurs entre l'écrit et l'oral et qu’elle prescrit de ramener l'écrit à une simple transcription de l'oral. Elle observe les écarts entre les deux modes de manifestation de la langue en rendant à chacun ce qui lui appartient. C’est un principe méthodologique ; ce n’est pas un hymne à l’oral au détriment de l’écrit, ou même de l’orthographe. Oui, l’orthographe du français est démesurément décalée de la prononciation, si on la compare à celle de l’italien (mais pas à celle de l’anglais) par exemple. Oui, elle est encombrée de chausse-trappes inutiles. Oui, il y a des adorateurs de l’orthographe comme il y en a du nombril, et cet arbre cache quelquefois la forêt. Non, il n’est pas sacrilège d’en éliminer quelques scories, comme cela a été fait par une commission ad hoc. Tout cela est vrai, mais ne prescrit en rien de déclasser l’écrit au profit de l’oral, avec toute sa labilité, dans la définition de « l’usage ». Concernant l’orthographe, chez les linguistes, il en est qui sont favorables à une réforme la rendant plus proche de la phonétique ; et il en est d’autres qui estiment que les inconvénients incontestables qu’elle présente sont largement compensés par d’autres mérites qu’il serait dommage de sacrifier. Ce sont des opinions défendables ; cela ne ressort pas d’une doxa inscrite dans le marbre du savoir linguistique.
Descriptivisme vs (contre) normativisme
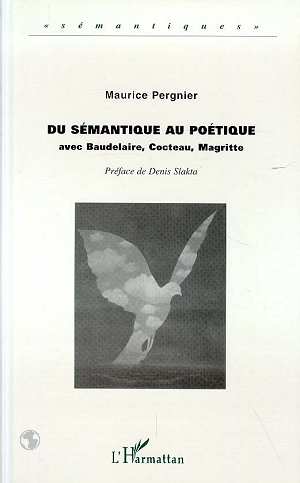
De même, ce n'est pas parce qu'elle considère que l'approche normative est une mauvaise clé d'entrée dans la découverte des structures réelles de la langue, que la linguistique nie l'existence ou la nécessité d'une norme et qu'elle demande son abolition. C'est une donnée que la linguistique prend en considération et dont elle essaie de rendre compte. Croire aux vertus de la normativité ou, au contraire, souhaiter son extinction, ce sont des opinions, peut-être également respectables, mais ce n'est pas un « acquis de la linguistique ».
De même encore, et pour les mêmes raisons, ce n'est pas parce que la linguistique constate que la langue évolue et que, parfois (mais pas toujours, contrairement à ce dont nos pamphlétaires semblent vouloir nous persuader) la « faute » d'hier devient la norme d'aujourd'hui, que la linguistique prône que toute nouveauté introduite est, par nature et par définition, un progrès digne d'être entériné. On constate d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus d'innovations qui sombrent dans l'oubli qu'il n'y en a qui s'instaurent durablement.
Si l’on en croit nos auteurs, tout ce qui est nouveau est mieux que ce qui est ancien ! Soit. Mais alors, pourquoi, par exemple (dans le chapitre consacré à la féminisation des noms de métiers), justifier l’emploi du malsonnant autrice comme féminin d’auteur, par le fait qu’il était employé au XVIIe siècle ? Ne serait-ce pas, justement, parce que cette forme déplaît à l’oreille qu’elle a été abandonnée ensuite, et non pour on ne sait quel motif anti-féministe ? Qu’on s’avise, en comparaison, que poétesse a fort tranquillement poursuivi sa carrière aux côtés de poète (mais, soit dit en passant, est-il attentatoire à la dignité féminine de dire que Louise Labé figure parmi les grands poètes du XVIe siècle ?). Tout est-il si simple ? Nos auteurs ne veulent sans doute pas défendre un point de vue aussi simpliste, et se récrieront probablement qu’on le leur prête. Ils mettent d’ailleurs parfois de l’eau dans leur vin (avec des arguments dont on comprend difficilement la cohérence avec la pétition de principe) ; mais la manière dédaigneuse et belliqueuse avec laquelle ils attaquent toute position qui n’adhèrerait pas d’emblée à cette pétition de principe mène tout naturellement à conclure qu’ils la défendent sans nuances.
Venons-en à l'aspect le plus surprenant de ce libelle, qui réside dans le paradoxe de prendre parti avec véhémence pour imposer envers et contre tout (il vaudrait mieux dire : contre tous) des inventions langagières, au nom du principe inverse de non-intervention dont il proclame qu'il est « un acquis de la linguistique ». Peut-être ne s'en sont-ils pas avisés, mais militer pour l'inscription immédiate dans la norme de tout ce qui travaille présentement la pâte de la langue française (genrisme, anglicisme, etc.), et tirer à boulets rouges (même si c'est parfois en visant juste) sur tous ceux qui y opposent une résistance – et qui sont dénoncés globalement comme « puristes [5]» – c'est tout ce qu'on veut, sauf une pratique de la réserve descriptiviste des pères fondateurs de la linguistique. Il faudrait s'entendre : ou bien les linguistes observent et décrivent sans se mêler de prescriptivisme et d’aménagement linguistique ; ou bien leur rôle est de prescrire les nouvelles règles (un mot qui revient souvent sous leur plume dans la dernière partie du manifeste pour désigner les innovations qu’ils veulent injecter de force dans la langue) qui doivent présider à la norme du français de demain ; dans ce dernier cas, pourquoi se réclamer de la scientificité d'une démarche purement descriptive ?
Pour nos auteurs, le problème de la bonne santé du français – si problème il y a – ne réside pas dans certains aspects de son évolution présente ; il réside dans la résistance qu’opposent à son évolution triomphale des bataillons de grincheux brandissant des arguments fallacieux (des « contre-vérités » est-il écrit péremptoirement à différentes reprises). C’est le sens du titre-même du pamphlet : Le français va très bien, merci. Les bonnes nouvelles sont si rares, dans notre monde tourmenté, qu’on aimerait que cet ouvrage nous en persuade. Las ! ce titre n’est pas l’annonce d’un diagnostic, dont on accueillerait la démonstration avec bonheur ; c’est une invective à l’endroit de l’hydre à mille têtes des grincheux qui pensent mal dans ce domaine, et à qui on va régler leur compte une fois pour toutes ! On notera comment le « Merci » vengeur exclut toute discussion. On a le droit, pourtant, de considérer que « ça se discute » … même quand on est linguiste.
[5] Les puristes existent, j’en ai rencontré (nonobstant le fait que la « pureté » de la langue, j’en suis d’accord avec les auteurs, est une « pure » vue de l’esprit). Mais où a-t-on vu qu’ils peuplassent les institutions, les médias, les écoles, et même la foule anonyme, comme on nous le donne à entendre ? Le malheureux usager de la langue française qui ose penser que « je ne sais pas » est préférable à «ch’ais pas » (même s’il reconnaît humblement avoir souvent la faiblesse d’en user lui-même !), ou qui estime que le « surmenage » exprime mieux le mal dont il souffre que le « beurre-na-août » (burn-out en français écrit), est-il puriste ? À ce compte, oui, le monde francophone est peuplé de puristes qui s’ignorent. Et si le purisme est une déviance idéologique, cela fait beaucoup de monde à rééduquer.
L’évolution de la langue
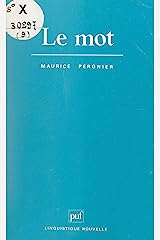
Quant à l'évolution de la langue, c'est une question qui est traitée de manière pour le moins cavalière (renvoyant aux poubelles de l'Histoire les travaux de générations de linguistes et philologues qui se sont démenés à essayer de l'éclairer). Pourquoi, comment, évolue-t-elle ? Ne cherchez pas ! Elle évolue, c'est tout, de même que le courant d'un fleuve avance imperturbablement. Ceux qui la parlent n'y seraient-ils pas un peu pour quelque chose, consciemment ou à leur corps défendant ? On ne le saura pas.
Nos auteurs avancent, à l'appui de leur théorie, un certain nombre d'exemples d'évolutions présentes à l'intérieur de la langue française, les présentant comme relevant toutes du même processus. Ainsi plaident-ils avec les mêmes arguments pour la « dépénalisation[6] de l'invariabilité des participes passés avec l'auxiliaire avoir », et pour l'adoption des marques genrées (notamment le pronom iel) et des anglicismes, sans que leur savoir linguistique semble leur faire percevoir que ces deux phénomènes d'évolution relèvent de causes différentes.
[6] Par ce mot terrible, on entend sans doute le fait de retirer un demi-point (voire un quart de point) au collégien qui ne fait pas cet accord dans sa dictée, ou au candidat à l’ENA qui le transgresse dans sa dissertation. On frémit en pensant au nombre de carrières qui s’annonçaient brillantes et ont été inexorablement brisées à cause de cette pénalisation scélérate ! Mais passons…
Le participe passé avec avoir

Un linguiste purement descriptiviste qui aurait observé de près le système verbal du français il y a un siècle avec les méthodes de la linguistique structurale aurait pu prévoir que l'accord du participe avec avoir tendrait à devenir obsolète, en raison d’une conjonction de causes résidant dans le système linguistique lui-même.
En schématisant à l'extrême : ledit participe souffre, d’une part, de son statut hybride, fluctuant entre élément de temps verbal et adjectif ; et d’autre part de ce que, à l’oral, la prononciation ne marque plus depuis belle lurette l’opposition masc./fem. pour les verbes du 1er groupe, de loin les plus nombreux (on a le droit de s’en affliger, mais il n’y a pas de différence de prononciation du mot atterré(e), qu’on parle d’un ou d’une linguiste) et, pour eux, l’accord est purement orthographique.
La tentation était donc puissante d’aligner les participes de tous les verbes sur ceux du 1er groupe[7].Doit-on en tirer la conclusion qu’il faut « dépénaliser » l’absence d’accord. Cela se discute, mais en tout état de cause, la décision ne découle pas mécaniquement d’un quelconque acquis de la linguistique. Et, soit dit en passant, on peut bien « dépénaliser » l'accord; on n'empêchera pas pour autant que nombre de francophones, qui ne se sentent pas particulièrement puristes, continueront longtemps d’avoir des grincements de dents à l’écoute (et pas seulement à la lecture !) d’énoncés comme « l'erreur que j'ai fait » ou « l'enveloppe qu'elle m'a remis » (ce qui tendrait à prouver que l'accord du participe, même s'il est neutralisé à l'oral pour la majorité des verbes, n'est peut-être pas juste une lubie sans fondement des grammairiens. ). Il ne manque pas de sujets semblables, sur lesquels les vrais « acquis de la linguistique » (et non ses prolégomènes) pourraient aider à clarifier les questions en débat chez ceux qui ont la charge de normaliser la langue.
[7] Pourquoi cela touche-t-il plus la forme avec avoir que celle avec être ? L’expliquer ici serait long et hors de propos. Mais cela s’explique aussi.
Des pressions sur la langue

Mais il est des évolutions qu'on ne peut pas ramener à ce type de cause inscrite dans le système. Ce sont toutes celles qui tiennent à l'interventionnisme délibéré d'un groupe influent d'utilisateurs de la langue (par exemple – comme nos auteurs l’évoquent excellemment – la volonté des lettrés du 16e siècle de distinguer, dans la graphie, les mots d'origine grecque, en les affublant de ph, y, etc. en lieu et place des f et i latins), ou à la projection directe dans la langue d'une situation de pouvoir autoritaire (une illustration bien connue en est fournie par Victor Klemperer avec sa "langue du 3e Reich", mais on pourrait en rechercher de semblables par exemple dans la façon dont le système soviétique a impulsé des changements à la langue russe, sans même qu’il soit besoin d’évoquer la novlangue d’une célèbre fiction…). Certaines des évolutions que nos linguistes atterré(e)s estiment urgent de promouvoir entrent dans cette deuxième catégorie : rien, dans le système de la langue française telle qu’elle nous a été transmise ne la prédispose à évoluer vers un usage « genré » des pronoms, ou vers une injection massive d'emprunts à une autre langue. Ces phénomènes reposent sur des causes de nature politique (au sens le plus large) ou idéologique, et doivent tout aux conditions sociologiques du moment, c'est-à-dire à la pression agissante de groupes (parfois ultra-minoritaires) déterminés à les imposer. Concernant les solutions proposées pour « genrer » la langue, chacun peut constater que ce sont de pures inventions (dont on peut parfois apprécier l’ingéniosité – ce qui n’en réduit pas l’artificialité) qui ne doivent rigoureusement rien aux structures internes de la langue.
Le caractère idéologique de tout cela est tellement patent que l'essentiel de l'énergie consacrée par les auteurs du pamphlet l’est, non à en défendre le bien-fondé et à étudier les conditions de son acceptabilité par la masse non idéologisée des locuteurs du français, mais à déverser des tombereaux de mépris sur les personnes et les institutions qui ont le front de ne pas y adhérer avec enthousiasme. Ce sont les « puristes », ceux qui ont « une lecture nationaliste du français », ceux qui, comme l'Académie, défendent « une conception qui confond langue et littérature », etc.
De prétendus « anglicismes »

C'est sur la question des anglicismes que les « puristes » sont les plus néfastes à la langue française. À la p. 16, on nous présente d'abord la question comme ceci : « on entend dans les médias les puristes se plaindre de ce qu’ils appellent les anglicismes ». Difficile d'exprimer plus clairement que les griefs des « puristes » sont à prendre avec de très longues pincettes : d'abord, ces grincheux ne présentent pas des points de vue ou des arguments, ils « se plaignent ». Et surtout, ils polluent le débat scientifique en utilisant un terme qui n'appartient qu'à eux. Ce serait donc là, semble-t-il un terme idéologique ? Mais alors, si ces faits linguistiques ont néanmoins une existence, comment faut-il les nommer (italianismes, russismes ?). Mais peut-être n'existent-ils pas et sont-ils une pure invention des « puristes ».Quelques lignes plus loin les auteurs condescendent à parler « d'emprunts à l'anglais », mais ne nous disent pas si ce terme est la version non urticante d’« anglicismes ». Quoi qu’il en soit, le problème que ces « non-anglicismes » soulèvent – nous disent nos auteurs – c'est que les notions brandies par les puristes, dont le franglais inventé par Étiemble en 1964, n'ont pas d’« assise scientifique ». C'est possible, et d'ailleurs Étiemble a-t-il revendiqué une quelconque scientificité pour asseoir son propos ?
La lecture de ces sentences éveille naturellement chez le lecteur la curiosité de savoir sur quelle « assise scientifique » repose l'opinion contraire à celle des puristes pourfendus. Il restera sur sa faim, la suite du plaidoyer n'étant qu'une reprise d'affirmations indéfiniment répétées depuis des lustres, comme par exemple que « La langue a le sens pratique, elle emprunte pour s'enrichir ». Idée reçue s'il en est, qu'on se gardera de discuter ici, mais dont le moins qu'on puisse dire est que – même en dehors de la linguistique – elle prête à discussion, tant tout le monde (pour ce qui concerne les anglicismes) pourrait en fournir de nombreux contre-exemples. Ce qui arrête davantage l'attention du lecteur linguiste non-signataire du pamphlet, ce sont les formulations « la langue emprunte pour... » et « la langue a le sens pratique » (sic). Il ne peut s’empêcher de rappeler que ce n'est pas la langue qui emprunte, mais ses utilisateurs. C'est le contact de langues chez un nombre plus ou moins grand d’individus qui mène à l'emprunt et/ou au calque, lequel ensuite se propage par mimétisme et est finalement adopté ou rejeté en fonction des conditions historiques ou sociologiques du contact. À moins de prêter à la langue je ne sais quel être biologique conscient, où trouverait-elle les ressources d’« emprunter » ou « d’avoir le sens pratique » ?
Ces déclarations péremptoires, de même que d’autres comme « Si l’on retient un mot c’est qu’il nous apporte quelque chose » ou « la recherche linguistique montre que la langue d’accueil (le français) n’est pas altérée par les emprunts » (et bien d’autres) sont des pétitions de principe, non des « acquis de la linguistique ». Il faut d’ailleurs signaler que le contact de langues à travers une frange de la population, et ce qui en résulte en matière d’emprunts et calques, a fort peu retenu l’attention théorique des linguistes, et qu’il fait généralement l’objet d’un appendice plus que marginal dans les traités, reprenant généralement sans examen les idées communément admises dans le public large. Pour ce qui concerne le français, ces idées à l’emporte-pièce se fondent sur les enseignements d’une longue histoire pendant laquelle les apports puisés dans d’autres langues (géographiquement proches ou lointaines) étaient extrêmement limités, et se limitaient en général à la nomination d’objets ou de réalités exotiques importés en même temps que le mot[8].
Il faut être fort peu observateur pour ne pas voir que les conditions du contact contemporain entre le français et l'anglais ont une spécificité sans précédent ? Les auteurs y font d'ailleurs allusion du bout des lèvres, mais répudient vivement l’idée qu'il pût relever, en conséquence, d'un traitement linguistique particulier. À la question soulevée, ils répondent par des considérations générales (et fort mal établies, comme on vient de le voir) sur le phénomène de l'emprunt et par des apostrophes dédaigneuses à l'encontre des légions de « puristes » qui font obstacle à la science supposée établie.
Oui, il y a des emprunts (même à l'anglais contemporain !) qui ont une utilité pratique. Mais, pour de nombreux autres, on serait bien en peine de soutenir en quoi ils concourent à l'enrichissement de la langue emprunteuse. Les auteurs, d'ailleurs, mettent eux-mêmes un bémol à leur plaidoyer pour l'ouverture sans limite de la langue française à l'anglicisation (pardon pour ce terme inconvenant !) en trouvant abusifs certains « jeux avec l'anglais » opérés par des « communicants » dans les slogans publicitaires (p.19). Mais ils précisent tout de suite après que ce qui les chagrine, c'est moins « l'abus » lui-même que le fait qu'il donne du grain à moudre à l'ennemi en « alimentant les discours puristes anti-franglais », et particulièrement – horreur ! – à l'Académie française qui les a « fustigés » (non pas « critiqués » mais « fustigés ». Notons le registre de vocabulaire !). Par ces « excès » les « communicants » nuisent à la bonne et juste cause de l'ouverture sans réserve aux anglicismes. Faut-il comprendre que, pour être acceptés sans rejet douloureux, les anglicismes doivent, comme les suppositoires, être administrés dans un geste consumer-friendly, et non à la hussarde ?
Cependant, en appelant les « communicants » à la modération, nos auteurs nous rappellent – involontairement, mais fort à propos – que ce n'est pas la langue qui emprunte ou anglicise, mais des catégories sociologiques d’usagers, nommément celles qui sont le plus en contact avec les langues étrangères. L’anglicisation (si l’on ose employer encore ce mot impie), donc, n’a pas seulement des causes sociolinguistiques identifiables et étudiables ; elle a aussi des agents. Dont acte ! Est-il permis de suggérer ici timidement que ces communicants n’ont pas forcément d’intentions malveillantes vis-à-vis de la langue française, mais qu’ils « communiquent » souvent sans avoir de formation suffisante dans la connaissance de l’anglais et en matière de traduction (et bien sûr, en linguistique !) et qu’ils prennent souvent des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire un terme étranger pour un concept nouveau sans équivalent français ?
Ne poursuivons cependant pas plus loin ces considérations ; cela risquerait de nous conduire à un vrai débat de linguistique entre linguistes. Or, on le voit, on n’est pas, ici, sur ce terrain. Résumons : oui, ce collectif de linguistes a parfaitement le droit d'être favorable à l'anglicisation du français sans entraves. Que cette position découle de l'application des découvertes d'un siècle de travaux des linguistes, cela est en revanche des plus douteux.
Sur ce point, comme sur les autres évoqués plus haut, on ne peut qu'être frappé par une contradiction qui imprègne l'ensemble du manifeste : on avait cru comprendre que, au nom de la vocation descriptive de la linguistique, les praticiens de cette discipline devaient s'abstenir de toute position prescriptive en matière de norme ou de planification linguistique ; or, voilà qu'on nous assène un discours de bout en bout prescriptif, en faveur d’une politique d’imposition au forceps des innovations voulues par des groupes de pression, conscients ou non de leur influence sur la langue. Peut-on proclamer une chose et son contraire ?
*
On ne poussera pas plus avant ce commentaire, déjà trop long pour la patience du lecteur, bien qu’il laisse dans l’ombre beaucoup de points qui mériteraient discussion. S’il faut en tirer une conclusion, elle s’est dégagée d’elle-même : nul ne conteste aux signataires de ce manifeste leur droit imprescriptible à défendre avec pugnacité les convictions qui sont les leurs ; mais rien ne les autorise à enrôler « la linguistique » et tous les linguistes – morts et vivants confondus – dans un combat qui est exclusivement le leur. Il est possible que, présentement, dans nos universités, on rencontre beaucoup de linguistes qui partagent les opinions défendues par ce manifeste, et qui pensent en toute honnêteté qu’elles découlent directement d’un savoir « faisant consensus au sein de la communauté scientifique »; si tel était le cas, cela prouverait seulement que la linguistique en vigueur dans nos universités a coupé le cordon ombilical avec la discipline dont elle se réclame pourtant avec autorité.
Maurice Pergnier
Professeur hon. de linguistique à l’université Paris-Est-Créteil, auteur notamment de Les fondements sociolinguistiques de la traduction (Les Belles lettres, 3e éd.), De Saussure à Saussure, Le Cours de Linguistique générale à l’épreuve du siècle (L’Age d’Homme), et Les anglicismes, danger ou enrichissement pour la langue française ? (P.U.F.)
Juin 2023
[8] Les auteurs n’hésitent pas à affirmer, d’un côté, que « la recherche linguistique (N.B. la quelle ?) montre que la langue d’accueil n’est pas altérée par les emprunts », et de l’autre, à donner en modèle le cas du vieil anglais, amené à cohabiter avec le français en raison de la conquête normande, qui représente l’exemple le plus illustratif qui soit d’une langue bouleversée (« altérée » ?) de fond en comble par son contact avec une autre (en l’occurrence, la langue de la classe dominante normande). Certes, force est de constater, un millénaire plus tard, que cette hybridation n’a pas nui au rayonnement de l’anglais ! Quant à savoir si elle y a contribué, s’il y a un lien entre les deux choses, et si cet exemple historique est un bon modèle pour traiter des apports contemporains de l’anglais au français… rendez-vous dans un millénaire pour le savoir.
Publié par Régis RAVAT le 08 juillet 2023
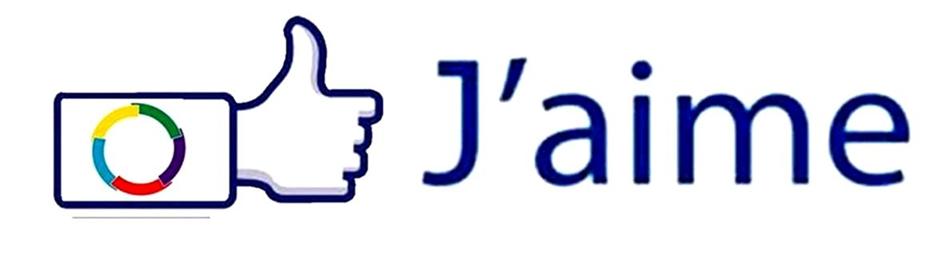 0 personne aime cet article.
0 personne aime cet article.
Orthographe, corrections : contact.sy@aliceadsl.fr






Identification
Veuillez entrer vos identifiants..
Créer un compte